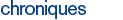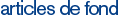|
Le sigle qui vous distinguede Stuart Foxman |
Voici un jeu auquel vous ne voudrez peut-être pas jouer, mais qui peut vous enseigner une très précieuse leçon. Il s’agit de la Course au succès. La Course au succès fait partie de la formation offerte aux
enseignantes et enseignants qui accompagnent les élèves
de 7e et 8e année au camp de leadership étudiant
Students Together against Racism (STAR). Ces derniers désignent
d’éventuels meneurs parmi les élèves de
30 écoles du Durham District School Board pour participer à une
sortie de quatre jours qui se tient chaque automne dans un terrain
de camping boisé au bord de l’eau. La plus récente
rencontre a eu lieu à Haliburton. Pour pouvoir participer au
programme, les pédagogues doivent d’abord se familiariser
avec les enjeux de diversité et d’inégalité qui
définissent leur propre milieu social. Les enseignantes et enseignants s’alignent, épaule contre épaule,
sur la largeur de la pièce. Le meneur du jeu explique qu’ils
doivent faire un pas en avant ou en arrière, selon leur propre
expérience de vie. Par exemple, un pas en avant si on a vécu
avec ses deux parents quand on était petit. Un pas en avant
si on paye quelqu’un pour faire le ménage chez nous. Un
pas en arrière si on est un Canadien de première génération;
et ainsi de suite. Il peut y avoir jusqu’à 50 ou 60 catégories
qui sont données en succession rapide jusqu’à ce
que chacun ait trouvé sa place dans la salle. Pour clore le
jeu, le meneur se place à l’avant et dit aux participants
qu’il a un emploi à offrir. Il s’agit d’un
poste de rêve que tout le monde désire, avec un excellent
salaire et un grand prestige. La première personne à atteindre
le meneur obtiendra cet emploi. Un, deux, trois... partez! La Course au succès est une immersion kinesthésique dans les concepts fondamentaux de l’équité et de la diversité. La déconstruction de cet exercice tout simple illustre clairement aux enseignantes et enseignants les répercussions de facteurs comme le statut social, la race et la classe sur les réalisations des élèves. Est-ce vraiment la personne la plus rapide qui a gagné la course, ou est-ce plutôt celle qui avait le plus de chances de son côté? Comment ont réagi les personnes reléguées au fond de la pièce? Ont-elles tenté de courir encore plus vite ou ont-elles simplement abandonné puisqu’elles n’avaient aucune chance de gagner? Un jeu axé sur l’honnêteté
|
 |
|
Des élèves de l’école publique Altona Forest de Pickering jouent à Franchir la ligne. |
«Les élèves voient émerger des tendances
quand ils constatent qui franchit la ligne avec eux. Ils découvrent
qu’ils ne sont pas seuls», ajoute sa collègue, Marie
Thomas, EAO, qui donne des cours de français de base et de langue
en 7e et en 8e année.
Comme l’explique Mme Thomas, leur école dessert «un grand nombre de jeunes culturellement et socialement marginalisés». Cette dernière enseigne depuis 10 ans, étant arrivée en Ontario en passant par Trinidad et le Québec, province où elle a obtenu une formation en ALS à l’Université McGill. Elle accompagne depuis quatre ans les élèves au camp STAR, dont trois ans à titre de membre du comité organisateur. Elle forme maintenant des finissants du secondaire pour travailler comme conseillers au camp STAR et est responsable du programme de 24 heures offert sur place au personnel enseignant.
J’ai fait un rêve
La stratégie STAR veut que les élèves retournent à l’école
avec un projet. Depuis quatre ans, Mme Thomas encourage
l’école entière à participer à son
assemblée annuelle J’ai fait un rêve organisée
en janvier pour souligner l’anniversaire de Martin Luther King.
Les 450 élèves de l’école publique Altona
Forest rédigent des discours sur leurs rêves d’avenir
et certains textes de jeunes de 8e année sont lus
au cours de l’assemblée.
«Cette année, plusieurs élèves ont rêvé que
la guerre en Palestine était terminée. Leurs rêves
sont tous inspirés d’expériences personnelles et
lorsqu’on associe leurs discours aux propos de Martin Luther
King, ils se sentent validés. Des élèves autrefois
silencieux trouvent leur voix.»
Mme Mulligan a choisi de participer au camp pour en savoir plus sur le racisme. «Parce que je suis blanche, je n’ai jamais été victime de racisme.» Au camp, elle a constaté que le racisme s’enchâssait dans un éventail d’avantages et de désavantages – et faisait partie d’un tableau général englobant, entre autres, la race et la religion.
«Les pédagogues doivent d’abord se familiariser avec les enjeux de diversité et d’inégalité qui définissent leur propre milieu social.»
«C’était intéressant de voir que chaque
participant, chaque enseignant, chaque élève a son fardeau à porter,
l’impression de ne pas avoir été accepté à un
moment donné. Ce n’était pas juste l’élève
portant le hijab ou l’élève en fauteuil roulant
qui avait un sentiment d’insécurité.»
Malgré tout, au Canada, les élèves (et enseignants)
qui portent le hijab ou se déplacent en fauteuil roulant rencontrent
plus d’obstacles que d’autres sur la route du succès.
Et, selon Philip Howard, EAO, l’agent responsable de l’équité,
de la diversité et des relations raciales au Durham DSB, il
est essentiel de bien comprendre la nature des obstacles systémiques
qui se posent.
«Si les élèves n’arrivent pas à saisir la dimension systémique de l’inégalité et mettent uniquement l’accent sur les cas flagrants de sectarisme, explique Philip Howard, ils vont ignorer 80 % des manifestations de sectarisme qui secouent le monde contemporain.»
Jeu de la ville
À l’école publique Dr. Roberta Bondar d’Ajax,
des équipes d’élèves de 8e année
rivalisent pour voir qui construira la meilleure nouvelle collectivité.
Mais même si leur ville est faite de papier, de ficelle et de
ruban gommé, les obstacles auxquels ils se heurtent et le type
de soutien qu’ils obtiennent afin de financer et de concrétiser
le projet sont bien réels – et très diversifiés.
C’est un jeu que leur enseignant, Edson Breceda, EAO, a lui-même
appris au camp STAR.
Il y a une décennie qu’Edson Breceda a quitté la
ville de Monterey, au Mexique, pour venir s’installer ici. Ce
sont ses propres expériences qui lui ont fait prendre conscience
des obstacles systémiques. «J’ai connu le racisme,
explique-t-il. Je ne veux pas que mes élèves soient obligés
de vivre la même chose que moi.»
Après avoir obtenu son diplôme de l’Université Trent,
M. Breceda a travaillé pendant un an comme adjoint à l’éducation
au Durham DSB avant de s’inscrire à la faculté d’éducation
de l’Université York. Depuis son séjour au camp
STAR, il a mis sur pied plusieurs projets avec ses élèves,
surtout des néo-Canadiens venant des Caraïbes et de l’Asie
du Sud.
Il a présenté le Jeu de la ville aux élèves comme un exercice d’équipe, les divisant au hasard en trois collectivités regroupées au sein d’une grande ville. Il a attribué une aire de travail particulière à chaque équipe. Dès le départ, il y a une intention cachée, puisqu’une des équipes obtient une aire de travail plus spacieuse. Les élèves ne le remarquent pas, car ils sont excités et ont hâte de commencer à construire. Mais avant, chaque équipe doit concevoir un plan et le faire approuver.
 |
 |
|
À l’école publique Dr. Roberta Bondar d’Ajax, l’enseignant Edson Breceda joue le rôle du maire durant le Jeu de la ville. |
Des élèves de l’école élémentaire catholique Terre-des-Jeunes d’Ottawa célèbrent l’arrivée des grandes vacances. |
L’enseignant agit comme maire, délivrant les permis de
construire et distribuant les matériaux. Il fait aussi office
d’agent de police et de gardien de prison quand un élève
déroge aux consignes. Ce que les élèves ne savent
pas, c’est qu’il existe un préjugé favorable
et arbitraire à l’endroit de l’une des équipes.
L’enseignant a pour tâche de compliquer subtilement la
vie à l’une des équipes afin qu’elle ait
plus de difficulté à bâtir sa collectivité.
Par contre, l’équipe installée dans l’aire
spacieuse profite d’un traitement préférentiel.
Le traitement réservé à la troisième équipe
se situe entre ces deux extrêmes.
À mesure que les élèves travaillent à ériger
leurs bâtiments, les membres d’une des trois équipes
sont de plus en plus frustrés. Ils n’obtiennent jamais
assez de matériaux, leur aire de travail semble rapetisser et
ils se retrouvent souvent en prison.
Le jeu terminé, la classe détermine quelle collectivité semble être est la meilleure, la plus grosse et la plus belle. M. Breceda demande ensuite à chaque équipe pourquoi elle croit avoir gagné ou perdu. Certains membres de l’équipe désavantagée déclarent immédiatement que «ce n’était pas juste!» Par contre, les membres de l’équipe privilégiée voient les choses autrement. «Nous avions les meilleurs plans, expliquent-ils. Nos dessinateurs étaient plus habiles.»
«Les gagnants ont du mal à admettre que leurs réalisations ne sont pas dues à leur propre mérite.»
Quand M. Breceda révèle aux élèves que
la situation était effectivement injuste et le préjugé intentionnel,
certains ne veulent pas le croire. D’autres se blâment,
déclarant : «Nous n’avons pas travaillé assez
fort». D’autres jettent le blâme sur leurs camarades
en disant «lui, il ne faisait rien» ou encore «c’est
elle qui a déchiré le papier».
Les gagnants ont du mal à admettre que leurs réalisations
ne sont pas dues à leur propre mérite et obtiennent souvent
l’appui de l’équipe du milieu.
«Les enfants n’arrêtaient pas de parler du Jeu de
la ville, explique M. Breceda. Ce jeu leur a permis de vivre une expérience
de discrimination systémique viscérale et leur a démontré combien
il est facile d’ignorer une situation quand nous ne sommes pas
la cible.
«La discrimination n’est peut-être pas aussi délibérée
qu’elle l’était dans le jeu, mais ses répercussions
sont les mêmes.»
Même les stéréotypes positifs peuvent avoir un
impact négatif. Quand la classe de 8e année de Carrie
Schoemer, EAO, de l’école Sir Alexander Mackenzie, à Scarborough,
a exploré ce sujet, elle a remporté un Prix national
du film vidéo pour sa production sur le thème À bas
le racisme!
La vignette vidéo de 30 secondes intitulée Are You Sure? est une merveille de simplicité qui remet en cause nos façons de penser. L’écran demande «Vrai ou faux ». Suivent, en alternance, des titres et des séquences réelles. La phrase «Les jeunes de race noire excellent au basket-ball» est suivie d’images d’enfants qui lancent le ballon (et ratent le panier). Suit l’énoncé «Les enfants d’origine asiatique sont forts en mathématiques», qui précède des images d’une classe où l’enseignante remet à un élève un examen avec la note E (pour échec) indiquée en gros. La déclaration «Les enfants de race blanche ne savent pas danser» s’accompagne d’une image d’un garçon blond s’adonnant au break dancing. Après le dernier titre «Le racisme n’existe pas au Canada. Êtes-vous certain?», on aperçoit une fille aux yeux foncés, debout toute seule dans un corridor d’école, appuyée avec nonchalance contre la porte d’un casier.
Les 34 élèves de la classe de Mme Schoemer
disent n’avoir jamais été victimes de discrimination
flagrante fondée sur la race. Pas un seul de ces jeunes n’est
blanc. «Ces élèves n’ont pas été directement
exclus ou rabaissés, explique l’enseignante, mais ils
subissent la pression des stéréotypes positifs. Ils se
sentent acculés au pied du mur.»
Le projet a eu des répercussions sur l’école entière. «Le
fait de produire cette vidéo nous a donné l’occasion
de parler ouvertement du racisme, explique Mme Schoemer.
Les gens ne veulent pas aborder la question; il faut donc mettre cartes
sur table. Cette vidéo a créé un contexte propice.»
Carrie Schoemer remet toutefois les choses en contexte. «Beaucoup de jeunes font des choses de ce genre dans leur classe sans nécessairement gagner de prix.» Elle souligne qu’il existe bien des façons d’intégrer la thématique de l’équité aux discussions de classe. «Il n’est pas toujours nécessaire de faire des gestes d’éclat. Parfois, il faut simplement permettre à chacune et chacun de faire entendre sa voix.»
Acquérir les bons outils
Carrie Schoemer précise que ce sont ses études à l’IEPO qui lui ont donné les outils nécessaires pour aborder les questions d’équité. «On nous a enseigné à chercher la perspective manquante, à cultiver la pensée critique, à se demander “Quelle voix raconte l’histoire, quelle voix se tait?”»
Natalie Middleton, EAO, a bien appris sa leçon et souligne l’importance d’un atelier intitulé Diversity Matters organisé par le Greater Essex County DSB dont elle relève. «On commence par un autoexamen afin de voir quels sont nos propres préjugés et partis pris.»
Natalie Middleton enseigne l’anglais et les capacités de lecture et d’écriture à l’école secondaire Century de Windsor. À l’instar de Carrie Schoemer, Natalie Middleton s’est toujours intéressée aux questions de justice sociale. «J’ai opté pour l’enseignement en raison du potentiel qui s’offre d’influencer les générations futures.»
«Dans une collectivité qui n’est pas habituée à la diversité, on observe un certain soulagement à appeler les choses par leur nom.»
La collectivité que dessert ce conseil solaire est la quatrième
plus diversifiée de la province. Des Canadiens de race noire
vivent depuis près de 200 ans dans cette région, véritable
centre industriel ayant attiré des vagues d’immigrants
au cours du XXe siècle.
À mesure que l’écart socioéconomique s’élargit
et qu’un nombre croissant de familles font face au chômage,
le degré de stress augmente, mais les problèmes peuvent être
difficiles à cerner.
«On ne peut réduire un écart si on ne le reconnaît pas», explique Mme Middleton. Même si elle fait référence aux besoins d’apprentissage spéciaux de ses élèves, cet énoncé a des ramifications plus larges.
«On ne voit pas toujours tout au premier coup d’œil, dit Mme Middleton, certaines choses se cachent sous la surface.»
Rachel Olivero, EAO, agente de la diversité au Greater Essex County DSB, est le cerveau et le cœur derrière les ateliers Diversity Matters auxquels a assisté Natalie Middleton.
Rachel Olivero croit que la diversité va beaucoup plus loin que les célébrations multiculturelles ou les journées spéciales dédiées à l’appréciation des us et coutumes d’autres peuples.
«Le racisme existe, explique-t-elle. Les pédagogues peuvent, par inadvertance, favoriser le statu quo en utilisant des mots et en posant des gestes qui ont des répercussions racistes, même si telle n’était pas leur intention. Il faut comprendre que le racisme peut être appris – et désappris.»
Un homme entre dans une classe réunissant 25 administrateurs et enseignants. Toutes ces personnes sont de race blanche, sauf lui. Il leur dit alors : «Décrivez-moi : âge, race, origines ethniques, orientation sexuelle».
Cheryl Caldwell, EAO, experte-conseil au Niagara DSB, se souvient que «les gens étaient très mal à l’aise et craignaient de faire un faux pas. Il a ensuite fallu qu’on se décrive nous-mêmes – ce à quoi nous ne sommes pas habitués».
Mme Caldwell examinait la documentation sur les politiques
d’équité du Toronto DSB, à titre de directrice,
quand elle s’est rendu compte que son propre conseil scolaire
n’en possédait aucune, même pas enfouie au fond
d’un classeur.
«On avait une très grande courbe d’apprentissage à faire.»
Cela l’a poussée à participer à un cours de six semaines offert par la Fondation canadienne des relations raciales intitulé Fondement à l’égalité et à la lutte contre le racisme.
«Ils étaient intéressés par notre perception de la diversité comme une force plutôt qu’une faiblesse.»
À Niagara, le profil démographique s’avère plus homogène que dans bien
d’autres régions de l’Ontario, mais la situation
est en train de changer. Et dans une collectivité qui n’est
pas habituée à la diversité, on observe un certain
soulagement à appeler les choses par leur nom et à fournir
aux participants les bons mots pour corriger les inégalités.
«Depuis le cours, notre collectivité s’est agrandie et nous pouvons maintenant nous poser des questions en utilisant un vocabulaire commun.»
Sandy Yep, EAO, responsable du cours Fondement à l’égalité et à la
lutte contre le racisme, est membre de l’AntiRacist Multicultural
Education Network of Ontario (AMENO), tout comme Rachel Olivero. Ce
regroupement informel, qui réunit des enseignants et des agents
de l’équité, est à la pointe de ce qui se
fait présentement dans nos écoles en matière
d’équité – il organise des ateliers, participe à la
rédaction du document stratégique du Ministère
et mène des consultations en vue d’élaborer des
lignes directrices pour offrir des cours menant à une qualification
additionnelle en matière d’équité. Chris
D’Souza, EAO, membre d’AMENO détaché du Dufferin-Peel
DSB auprès de l’Université York, s’affaire à élaborer
un module éducatif inclusif à l’intention des stagiaires.
Une fois approuvé, ce module deviendra obligatoire.
Modélisation de l’équité
Qu’en est-il de la diversité des pédagogues de nos écoles? Le Dufferin-Peel DSB met sur pied un programme de mentorat destiné aux enseignants de races diverses qui songent à devenir administrateurs. «Ils voient bien qu’il est important d’être représenté puisque moins de quatre pour cent des enseignants ne sont pas caucasiens.»
Cela dit, Arifa Ghaffar, EAO, une enseignante-bibliothécaire à l’école publique intermédiaire S.T. Worden de Courtice, croit qu’il ne suffit pas de mettre sur pied un programme de mentorat.
«À moins qu’on embauche beaucoup d’autres enseignantes et enseignants – et pas seulement à Toronto, à Peel ou à York – et qu’on accepte le changement, je ne pense pas que cela va faire une grosse différence.»
Mme Ghaffar occupe son poste actuel au Kawartha Pine Ridge DSB depuis deux ans en tant qu’employée occasionnelle à long terme. Son contrat ne peut plus être prolongé et les possibilités d’emploi sont rares.
Depuis qu’elle a quitté le Pakistan, il y a 14 ans, Arifa Ghaffar a clairement été victime de racisme. «On m’a accusée d’être une terroriste, d’être la sœur d’Oussama Ben Laden... tout cela parce que je porte le hijab.» Elle a aussi été frustrée par des manifestations de racisme plus insidieuses.
«La détermination de l’identité et de la culture franco-ontariennes passe surtout par le système scolaire de langue française.»
«J’ai rencontré une directrice d’école qui m’a dit : “Vous avez toutes les compétences nécessaires, mais nous n’avons pas d’élèves musulmans ici. Vous devriez aller chercher du travail à Toronto”. Je lui ai répondu : “Il n’est pas nécessaire que vous ayez des enfants musulmans – je suis enseignante”.»
Il est important d’avoir un modèle. Et cela est vrai pour tous; pas seulement pour les jeunes qui se sentent exclus.
 |
 |
|
Arifa Ghaffar, enseignante-bibliothécaire pour le Kawartha Pine Ridge DSB, se tient avec des élèves devant un montage de symboles de paix à travers les cultures. |
Abdelkarim Ouedhrefi, du collège catholique Samuel-Genest d’Ottawa |
Arifa Ghaffar a certainement profité au plus haut point de son séjour de deux ans, mettant sur pied, pour la première fois à cette école, une série de projets en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs ainsi que deux journées annuelles de la diversité qui ont remporté un franc succès. Ces journées, qui mettaient l’accent sur la musique et les arts, ont permis aux élèves d’assister à des ateliers rotatifs sur des sujets comme l’image corporelle, l’islamophobie, la roue médicinale autochtone et l’univers des sourds.
«À moins que des personnes représentant diverses races et religions enseignent aux enfants, ils ne pourront pas souscrire pleinement aux valeurs de la diversité parce cette dernière ne fera pas partie de leur réalité», fait observer Mme Ghaffar.
Abdelkarim Ouedhrefi, EAO, du collège catholique Samuel-Genest d’Ottawa, est bien d’accord. Il est responsable des programmes d’aide en français à l’intention des nouveaux arrivants : actualisation de la langue française (ALF) et perfectionnement du français (PDF). Cette année, il donnera également des cours de français, d’histoire, de géographie et de religion aux élèves de 8e année. Il s’agit d’un répertoire de tâches plutôt intéressant pour le seul enseignant musulman de cette école catholique, qui regroupe 48 cultures et ethnies différentes.
Né en Tunisie, M. Ouedhrefi travaillait auprès des jeunes avant de venir au Canada il y a 17 ans. «Je peux m’identifier à mes élèves. Mon propre cheminement de vie m’aide à comprendre un petit peu leurs problèmes et leurs expériences.
«Ici, à Ottawa, précise M. Ouedhrefi, on a besoin de tous les enseignants francophones disponibles.» Malgré tout, plusieurs ethnies et cultures demeurent sous-représentées. «Nous savons que les élèves s’identifient souvent à leur enseignante ou enseignant. Si nous voulons renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes de familles immigrantes, nous devons faire des efforts afin que le corps enseignant comprenne des membres de ces cultures et ethnies.»
L’un des principaux aspects de l’inclusion est le sentiment d’appartenance. Mais le personnel des écoles de langue française et de langue anglaise ne reflète pas la diversité de la population estudiantine.
Forces et défis
En août 2008, le Toronto DSB remportait le prestigieux prix Carl-Bertelsmann visant à récompenser l’engagement envers l’équité en éducation. La fondation allemande qui parraine ce prix a été impressionnée par les initiatives visant à éliminer les obstacles qu’affrontent les enfants d’immigrants et les jeunes à risque.
«Ils étaient intéressés par notre perception de la diversité comme une force plutôt qu’une faiblesse», indique Lloyd McKell, EAO, agent du conseil scolaire responsable de l’équité parmi les élèves et dans la collectivité.
«Les élèves francophones qui arrivent dans le système scolaire viennent de tous les coins du monde.»
Cela dit, même si la diversité peut constituer une force, il n’en va pas de même de la pauvreté. De fait, dans les grands centres urbains, la couleur de la pauvreté est de moins en moins blanche.
Une étude menée par le Toronto DSB et publiée en février 2009 a fait ressortir de constants écarts dans les résultats des tests normalisés de 3e année. Les plus grandes disparités semblaient survenir entre divers groupes raciaux, puis entre diverses catégories de revenus.
Les statistiques ne sont pas roses, mais que peut faire le système scolaire pour renverser cette tendance?
Défis relatifs aux programmes-cadres
Le Toronto DSB s’est récemment donné pour mission de réduire de 40 à 15 pour cent le taux de décrochage des élèves de race noire d’ici cinq ans. Pour atteindre cet objectif, il s’est doté d’outils, y compris le premier programme-cadre d’études sociales centrées sur l’Afrique offert de la maternelle à la 8e année dans toutes les écoles. En outre, 120 pédagogues ont été formés pour l’enseigner et une école parallèle centrée sur les cultures africaines ouvrira ses portes en septembre 2009.
Célébrer nos différences
Au collège J. Clarke Richardson de Pickering, le cours d’étude des Noirs, donné par Cheryl Rock, EAO, qui enseigne l’histoire et les communications, fait déjà une différence. Mis au point avec l’aide de collègues membres d’un groupe d’éducateurs de race noire, le cours est offert depuis quatre ans.
«Il y a un effet sur le niveau de participation, déclare Mme Rock. Au début, les élèves sont assis seuls et ne savent pas s’ils doivent lever la main ou non. Puis ils commencent à se mettre au défi et à s’entraider.»
Cheryl Rock est aussi responsable du groupe parascolaire Diaspora
Collective, un regroupement de meneurs «non conventionnels» qui
attire chaque année jusqu’à 50 jeunes. Puisque Mme Rock
est aussi une artiste visuelle, elle utilise le domaine des arts et
spectacles pour explorer des questions d’identité et de
différence, mettant les élèves au défi
de répondre à l’éternelle question que
l’on pose toujours aux Canadiens non blancs : «D’où viens-tu
vraiment?»
Les pédagogues francophones abordent rarement la question du lieu d’origine avec leurs élèves. De fait, selon la Politique d’aménagement linguistique publiée pour la première fois en 1994 et fortement révisée à la suite de consultations publiques en 2004, la détermination de l’identité et de la culture franco-ontariennes passe surtout par le système scolaire de langue française.
 |
|
Liz Mohn (à droite), vice-présidente de Bertelsmann Stiftung décerne le prestigieux prix Carl-Bertelsmann 2008 à John F. Campbell, président, et Gerry Connelly, ancienne directrice de l’éducation du Toronto DSB. |
Nathalie Sirois, EAO, travaille au Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques, à Ottawa. Selon elle, les questions d’équité et de diversité sont en même temps semblables et très différentes dans les écoles de langue française et celles de langue anglaise.
Les expériences et l’histoire varient considérablement.
Les parents de Nathalie Sirois se souviennent de l’époque
où des inspecteurs d’école étaient dépêchés
sur les lieux pour empêcher les pédagogues d’enseigner
en français dans leur propre école. Le plus ancien conseil
scolaire de langue française – le Conseil des écoles
catholiques de langue française du Centre-Est de l’Ontario – célébrait
récemment son 20e anniversaire. En Ontario, il n’y
a pas très longtemps que les droits linguistiques minoritaires
ont été acquis. Là encore, ce fut après
une dure bataille.
Malgré tout, quand on parle de diversité, force est de constater qu’à l’instar de leurs homologues anglophones, les élèves francophones qui arrivent dans le système scolaire viennent de tous les coins du monde. Ils s’intègrent à une culture minoritaire fière dont la langue constitue le grand point commun.
Fierté mutuelle
À l’école élémentaire catholique Terre-des-Jeunes d’Ottawa, les cours de langue servent à accueillir les nouveaux arrivants et à les aider à s’installer dans leur nouveau pays. Après une pleine année d’intenses demi-journées passées avec Jo-Anne Désilets, EAO, qui donne les cours d’ALF et de PDF, les élèves de 1re et de 2e année participent à une grande célébration de fin d’année avec leur classe régulière.
Que ses élèves viennent du Mexique, du Burundi, du Rwanda ou du Liban, Mme Désilets cherche à faciliter et à renforcer leur identité de jeunes Franco-Ontariens et à les intégrer à la culture franco-ontarienne.
«Puisque les francophones constituent une minorité dans cette province, dit-elle, c’est une chose que nous devons encourager. Il importe que les élèves connaissent notre histoire et en tirent de la fierté.»
«Elle croit que le facteur qui menace le plus l’équité en éducation, c’est la pauvreté et non la culture.»
Pour que les jeunes soient fiers de leur nouvelle identité et de leurs nouvelles racines, ils doivent comprendre que c’est quelque chose qui vaut la peine d’être défendu. «S’il existe aujourd’hui des écoles de langue française en Ontario, c’est parce que des gens se sont battus pour les obtenir et continuent de se battre pour elles.»
Mme Désilets explique sa perspective de l’interstice entre la race et la classe dans un contexte francophone. À Smooth Rock Falls, la petite ville au nord de Timmins où elle a grandi, 85 pour cent des habitants étaient francophones.
«Les Anglais étaient les patrons et les choses avaient
toujours été ainsi. Nous avons donc appris à nous
entraider. Je crois que si nous comprenons bien les immigrants qui
arrivent chez nous, c’est en raison de notre propre expérience
comme minorité.»
«Nous apprenons à digérer le fait que nous sommes
une majorité aux yeux des autres», admet Nathalie Sirois.
Cela dit, l’ajustement culturel exigé de certains enfants est plus difficile que prévu. Certains ont perdu leurs parents ou d’autres membres de la famille à la guerre. D’autres ont été témoins de génocides, de viols systémiques et d’autres horreurs. Certains ont même été des enfants soldats.
 |
|
Que ses élèves viennent du Burundi, du Rwanda ou du Liban, Jo-Anne Désilets (au fond) cherche à faciliter et à renforcer leur identité de jeunes Franco-Ontariens. |
Mme Sirois reconnaît l’énormité des
besoins. «On ne sait pas quoi faire pour aider ces enfants...,
ce qu’ils ont vu, ce qu’ils ont vécu!»
Pour rectifier la situation, elle a mis sur pied un cours d’été axé sur
l’étude du génocide. Le cours de l’Institut
canadien pour l’éducation sur les génocides a été offert à la
faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.
Plusieurs conférenciers de marque y ont participé, y
compris Roméo Dallaire et Barbara Coloroso, dont le livre sur
le génocide, Extraordinary Evil, vient d’être
traduit en français. Ce cours vise à mieux reconnaître
les signes de stress post-traumatique chez les élèves
et à réagir efficacement. Il aide aussi à aborder
la question des relations culturelles quotidiennes en classe en examinant
des cas de comportements humains extrêmes, comme celui des nazis
lors de l’Holocauste.
«On étudie la dynamique de l’intimidation et de la haine dans les grandes sociétés, mais il faut aussi reconnaître ses manifestations dans un contexte scolaire – et cesser de toujours percevoir le conflit comme un phénomène opposant deux personnes. C’est dans cette optique que l’étude du génocide est pertinente à la pratique de l’enseignement.»
Roue médicinale
À l’école bilingue Gron Morgan de Thunder Bay, Rachel Mishenene, EAO, place délicatement quatre grands morceaux de feutre, un blanc, un jaune, un noir et un rouge, en les orientant avec attention vers le nord, l’est, le sud et l’ouest, les quatre pôles de l’enseignement axé sur la roue médicinale autochtone.
Née dans la Première nation de Mishkeegogamang, à 500 kilomètres au nord de Thunder Bay, Rachel Mishenene est l’une des six personnes d’origine autochtone qui enseignent au Lakehead DSB.
Aujourd’hui, le soleil brille et Mme Mishenene, enseignante-ressource de l’enseignement autochtone, a choisi de donner ses cours à l’extérieur. Le printemps vient à peine de poindre dans cette collectivité et les 22 enfants assis en cercle sur le gazon ont beaucoup de mal à contenir leur énergie. Elle explique que les enseignements axés sur la roue médicinale lui ont été confiés par un ancien de sa collectivité traditionnelle et que l’ordre des couleurs et des orientations peut changer selon le lieu d’où viennent les gens, leur famille ou leurs terres.
«Il n’y a pas une seule bonne façon de faire les choses», explique Mme Mishenene. Elle attend que cet énoncé fasse son chemin dans la tête des jeunes, puis explique comment les quatre quadrants – les quatre couleurs – symbolisent les quatre trimestres du calendrier, chacun caractérisé par un animal spécial : la tortue, l’aigle, l’ours et le loup. Les couleurs représentent également les quatre races.
La roue n’a pas de hiérarchie; à mesure qu’elle tourne, différents aspects changent, tout comme la relation avec le tout.
Les élèves prennent place autour de la roue, puis reviennent vers le cercle. Ils apprennent à ne parler que lorsqu’ils tiennent la plume d’aigle que Mme Mishenene a apportée, et à rester silencieux quand les autres parlent. L’intensité de leur attention est fort étonnante.
 |
|
Les élèves de Rachel Mishenene, apprenent la roue médicinale à l’école publique Gron Morgan de Thunder Bay. |
«Les enseignements autochtones ne visent pas uniquement les
habitants des terres ancestrales – ils s’adressent à tout
le monde», affirme Rachel Mishenene. À titre de coordonnatrice
de l’Urban Aboriginal Education Project, elle a mis au point
des programmes d’enseignement à l’intention des élèves
de l’élémentaire et collaborait récemment
avec des enseignantes et enseignants du secondaire pour produire un
module de six jours sur les traités, les pensionnats et la Loi
sur les Indiens. L’enseignement de ces modules, qui font partie
du cours de citoyenneté de 10e année, sera
obligatoire dans l’ensemble du conseil scolaire de district Lakehead
cet automne.
«Il y a tellement de façons de constater la réussite d’un élève; son développement personnel, sa confiance en soi, soutient Mme Mishenene. Nombre de ces éléments ne peuvent être mesurés.»
Avant tout, elle croit que le facteur qui menace le plus l’équité en éducation, c’est la pauvreté et non la culture.
«Nous devons savoir à qui nous enseignons, dit Rachel Mishenene. Est-ce que les élèves ont faim? Ont-ils été incapables de s’endormir parce que leurs parents se disputaient? De quel type d’aide la famille a-t-elle besoin?»
Achèvement du cercle
Offrir une éducation équitable et inclusive dans une province aussi diversifiée que l’Ontario constitue, à n’en pas douter, un défi de taille. L’infrastructure est bien incomplète; seuls 43 des 72 conseils scolaires ontariens disposent d’une politique sur l’équité sous une forme quelconque.
Selon Karen Moch, vice-présidente et source d’inspiration du document stratégique du ministère de l’Éducation intitulé Comment tirer profit de la diversité, tout cela devra changer en 2010, une fois que tous les conseils scolaires seront tenus d’avoir de telles politiques. Mais la route est encore longue.
«La politique constitue une excellente carte routière, mais où mènera-t-elle si on est en panne d’essence?» C’est la question pointue que pose Tim McCaskell, ancien agent de l’équité au Toronto DSB et auteur de diverses ressources sur le racisme à l’intention des élèves et des enseignants. Il se demande si on a prévu assez de fonds pour garantir une mise en œuvre efficace.
Mais, comme l’affirme avec enthousiasme la directrice adjointe de l’école secondaire de Welland, Ann Kennerley, EAO : «On ne peut utiliser l’argent comme excuse pour ne pas se doter d’écoles équitables et inclusives».
Partout en Ontario, les enseignantes et enseignants déploient beaucoup d’énergie pour faire de l’équité une réalité quotidienne en classe.
Liens
Pour en savoir plus sur les ateliers, les ressources et les publications
dont il est question dans cet article, reportez-vous aux liens ci-dessous.
Organismes
AntiRacist Multicultural Education Network of Ontario (AMENO), est une association d’enseignantes et enseignants et d’agentes et d’agents de l’équité de la province. www.ameno.ca.
La Fondation canadienne des relations raciales offre des ateliers, y compris les fondations pour l’équité et la lutte contre le racisme. Consultez le site www.crr.ca ou envoyez un courriel à syep@crrf-fcrr.ca.
Students Together against Racism (STAR), s’inscrit parmi une
gamme d’initiatives à l’intention du personnel enseignant
et des élèves. Le programme est offert par le biais du
bureau de l’équité, de la diversité et des
relations raciales du conseil scolaire de district de Durham. Consultez
le site www.durham.edu.on.ca ou
envoyez un courriel à Howard_Philip@durham.edu.on.ca.
Ressources et concours
Pour en savoir plus sur le programme Black Studies de J. Clarke Richardoon
CI, envoyez un courriel à Rock_Cheryl@Durham.edu.on.ca.
L’Urban Aboriginal Education Project du Lakehead DSB offre des programmes-cadres à l’intention des élèves de l’élémentaire, ainsi qu’un module de six jours qui s’inscrit dans le cours de citoyenneté de 10e année. Rachel_Mishenene@Lakeheadschools.ca.
Mettons fin au racisme! est un concours annuel de vidéos parrainé par
le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.
L’Office national du film organise des ateliers à l’intention
des écoles qui participent à ce concours. www.cic.gc.ca.
Perfectionnement professionnel
Pour en savoir plus sur les ateliers Diversity Matters offerts par
le Greater Essex County DSB, allez à www.gecdsb.on.ca ou
communiquez avec Rachel Olivero,
EAO.
Pour obtenir davantage de renseignements sur l’Institut canadien
pour l’éducation sur les génocides de l’Université d’Ottawa,
envoyez un courriel à nsirois@cforp.on.ca.
Qualifications additionnelles
L’Ordre a mis au point une série de lignes directrices pour un cours sur les QA en trois parties de l’annexe D : Classes inclusives. Il traite maintenant les demandes des établissements approuvés qui désirent l’inclure dans leur choix de programmes.
Les membres de l’Ordre qui veulent suivre ce cours peuvent faire
une recherche à www.oeeo.ca pour
consulter la liste des fournisseurs approuvés par l’Ordre.
Documents stratégiques et rapports
La pauvreté a un code postal
Intitulée Poverty by Postal Code, cette étude axée
sur les quartiers de Toronto a été publiée par
Centraide en 2004. On peut en obtenir un exemplaire à www.unitedwaytoronto.com.
Comment tirer partie de la diversité : Stratégie d’équité pour
une éducation inclusive en Ontario
Ce document stratégique du ministère de l’Éducation
de l’Ontario est sorti en avril 2009. Les conseils doivent se
doter de politiques sur l’équité d’ici 2010.
Le document stratégique peut être téléchargé à www.edu.gov.on.ca.
Le rapport Reconstructing Dropout (pour mettre fin au décrochage) de George Jerry Sefa Dei, Josephine Mazzuca et Elizabeth McIsaac a été publié en 1997 par University of Toronto Press. Pour l’emprunter de la bibliothèque de l’Ordre, allez à www.oeeo.ca.